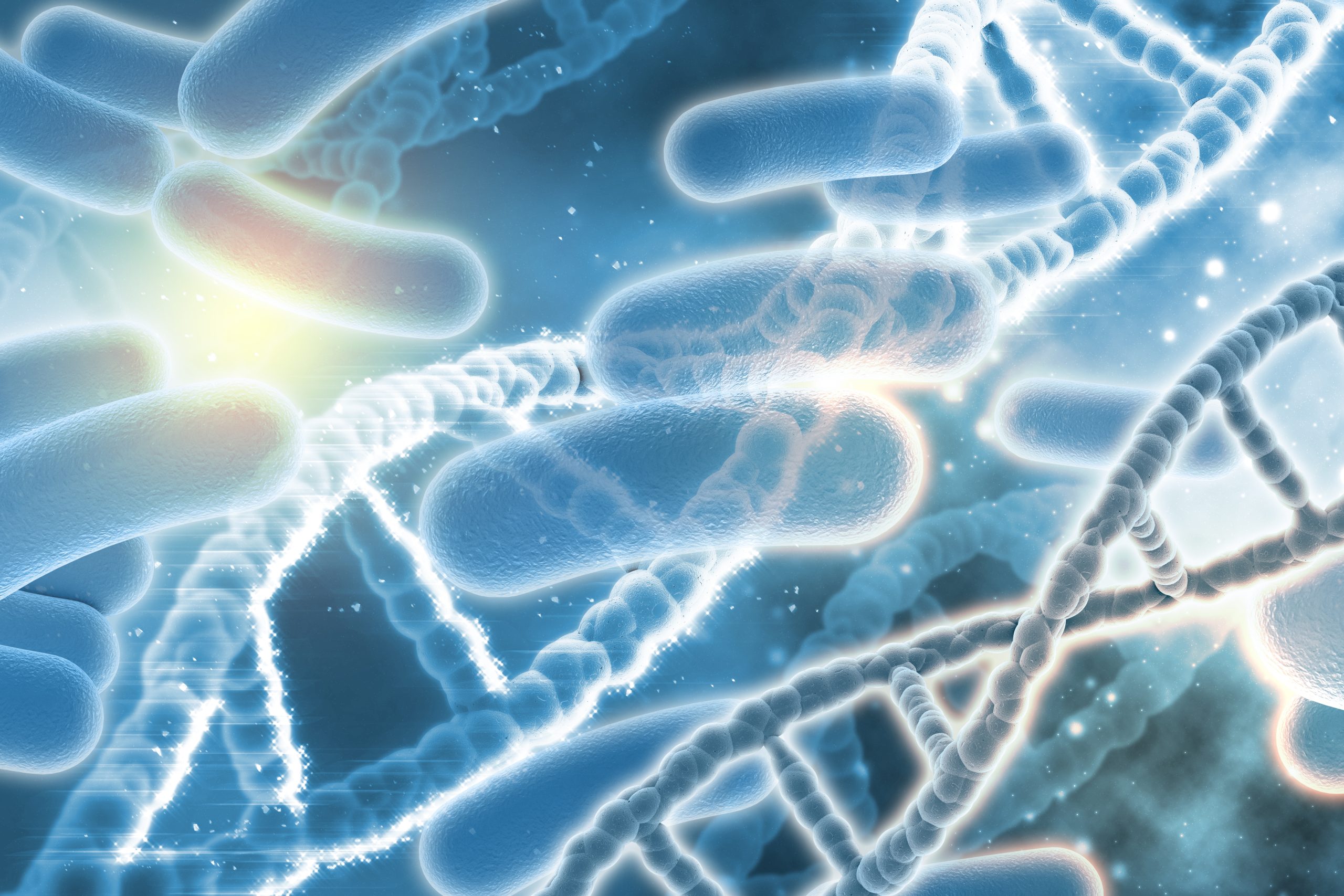Des chercheurs de l’Institut Curie, de l’Institut Pasteur et de l’Inserm ont identifié une protéine jusque-là inconnue chez l’humain, baptisée SIRal, ouvrant un pan inédit du fonctionnement de notre système immunitaire. Leurs résultats, publiés dans la prestigieuse revue Science le 24 juillet 2025, marquent une avancée majeure dans la compréhension de l’immunité et la lutte contre certaines maladies infectieuses et auto-immunes.
Une protéine d’origine bactérienne… chez l’homme
SIRal, contraction de “Similar to Inverted Repeat-adjacent lncRNA”, est une protéine issue d’un gène ancestral, vestige d’un mécanisme de défense bactérien apparu il y a plusieurs centaines de millions d’années. Ce type de transfert horizontal de gène, bien connu chez les micro-organismes, est beaucoup plus rare chez les êtres humains. L’identification de SIRal prouve pourtant que certaines fonctions immunitaires humaines tirent leur origine de systèmes bactériens primitifs.
Un rôle fondamental dans la détection des menaces internes
Selon les chercheurs, SIRal joue un rôle central dans la reconnaissance de l’ARN viral ou anormal dans les cellules. Elle agit comme une sentinelle intracellulaire, capable de détecter les signaux de danger et d’activer une cascade de réponses immunitaires. Cette fonction s’apparente aux mécanismes utilisés par les bactéries pour se protéger des virus, tels que les bactériophages, via les systèmes CRISPR-Cas.
Des perspectives en immunothérapie et en médecine de précision
La découverte de SIRal pourrait avoir des implications majeures en immunothérapie, notamment dans le traitement des cancers, des infections virales chroniques ou des maladies auto-immunes. En comprenant mieux ce mécanisme ancestral, les chercheurs espèrent développer de nouvelles stratégies thérapeutiques capables d’activer ou de moduler cette voie immunitaire selon les besoins.
Par exemple, stimuler l’activité de SIRal pourrait renforcer la réponse immunitaire contre une tumeur. À l’inverse, l’inhiber pourrait être bénéfique pour calmer une inflammation excessive ou une réponse auto-immune.
Une révolution en santé publique ?
Au-delà des applications cliniques, cette avancée enrichit considérablement notre connaissance du système immunitaire humain. Elle révèle que notre immunité n’est pas uniquement façonnée par l’évolution humaine, mais aussi héritée d’organismes microscopiques avec lesquels nous avons coévolué. En identifiant des mécanismes oubliés ou méconnus, la recherche permet d’élargir le champ des outils biologiques mobilisables en santé publique.
Dans un monde confronté à des pandémies, à la montée des maladies auto-immunes et à la résistance croissante aux traitements, révéler des systèmes de défense jusque-là ignorés est un atout stratégique majeur. Cela pourrait permettre à l’avenir de développer des vaccins ou des thérapies ciblées plus efficaces, basés sur des fonctions immunitaires naturelles encore inexploitées.
Une exploration qui ne fait que commencer
Les chercheurs soulignent que cette découverte n’est qu’une première étape. D’autres protéines ou voies immunitaires d’origine microbienne pourraient être présentes dans le génome humain sans avoir encore été identifiées. Grâce aux technologies de séquençage à haut débit et à l’intelligence artificielle appliquée à la biologie moléculaire, l’exploration de cette “immunité cachée” pourrait profondément transformer la médecine du XXIe siècle.
Mots clés : santé ; immunité ; technologie ; biologie ; molécule ; microbienne ;
à lire aussi: