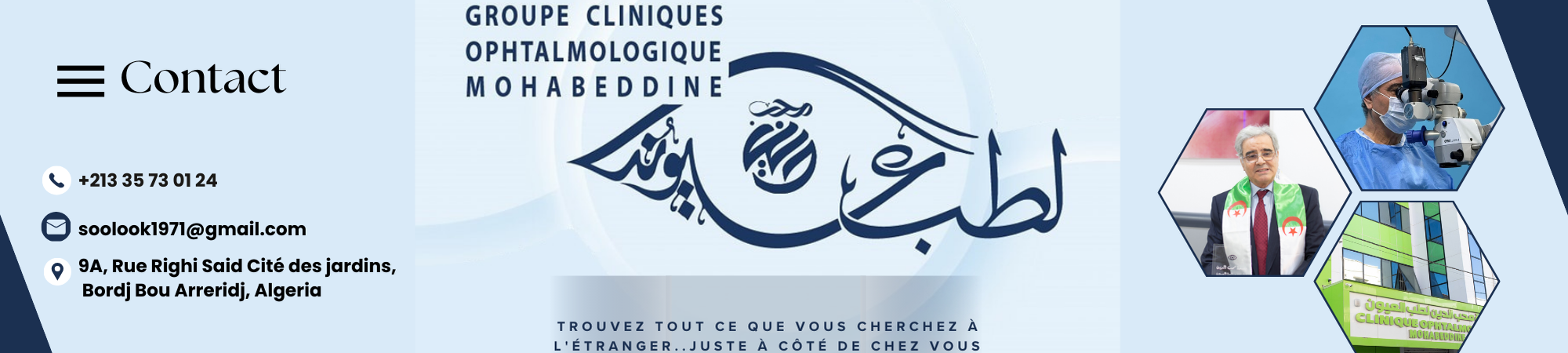À l’occasion de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, nous avons rencontré le Dr Salim BENLEFKI, docteur en neurosciences, dont les travaux portent sur la compréhension et la prise en charge des maladies neurocognitives. Dans un contexte où plus de 55 millions de personnes dans le monde vivent avec une démence — dont la maladie d’Alzheimer représente la forme la plus fréquente —, ses conseils résonnent comme une boussole pour les familles. Entre explications scientifiques accessibles, recommandations pratiques et regard profondément humain, il nous éclaire sur la manière de mieux accompagner un proche atteint de cette pathologie. Un échange où s’entrelacent rigueur médicale, empathie et une conviction forte : même face à Alzheimer, il existe toujours des leviers pour préserver la dignité, l’autonomie et l’espoir.
Ma Santé, Ma Vie : Dr Benlefki, pourquoi la maladie d’Alzheimer concentre-t-elle autant d’attention ?
Dr Salim Benlefki : Parce qu’elle est aujourd’hui la première cause de démence dans le monde. En Algérie, plus de 200 000 (en 2018) de personnes en sont atteintes. Mais il y a une nuance importante : toutes les démences ne sont pas des Alzheimer. Une personne sur cinq vit avec une autre forme de maladie neurocognitive. Cette confusion entretient des erreurs de diagnostic et parfois un accompagnement inadapté.
MSMV : Justement, comment différencier Alzheimer des autres maladies neurocognitives ?
L’Alzheimer débute le plus souvent par une atteinte de la mémoire récente. Mais ce n’est pas systématique. Certaines démences frontotemporales commencent par des troubles du comportement : désinhibition, perte d’empathie, impulsivité. La démence à corps de Lewy, elle, provoque des hallucinations visuelles très réalistes et des fluctuations cognitives. Dans la démence parkinsonienne, les signes moteurs précèdent les troubles intellectuels. Chaque maladie a sa signature. C’est pourquoi nous avons besoin de bilans complets : tests cognitifs, imagerie cérébrale et, de plus en plus, biomarqueurs sanguins ou du liquide céphalo-rachidien.
MSMV : Pour les familles, quels signes doivent alerter en premier ?
Souvent, ce sont elles qui remarquent les premiers changements. L’oubli répété d’événements récents est un signal classique. Mais il peut aussi s’agir de petites choses : ne plus trouver ses mots, se perdre dans un lieu familier, confondre des objets, ou encore présenter des changements de caractère. Un parent qui devient soudainement méfiant, anxieux, ou qui prend de mauvaises décisions financières, doit éveiller l’attention. Le message est simple : si un comportement inhabituel persiste, il faut consulter.
MSMV : Où en est la recherche ? Peut-on espérer un traitement dans les années à venir ?
La recherche progresse vite. Nous disposons désormais de traitements qui visent à ralentir l’accumulation des protéines toxiques dans le cerveau, notamment les immunothérapies. Les biomarqueurs sanguins, quant à eux, permettent de diagnostiquer la maladie plus tôt et plus simplement qu’auparavant. Mais soyons honnêtes : nous n’avons pas encore de traitement curatif. Notre mission aujourd’hui est double : ralentir la progression et améliorer la qualité de vie des patients.
MSMV : Peut-on agir en amont, avant même l’apparition des symptômes ?
Absolument. Nous savons aujourd’hui que certains facteurs de risque sont modifiables. L’hygiène de vie compte énormément : activité physique régulière, alimentation équilibrée, stimulation intellectuelle, maintien du lien social, mais aussi contrôle de l’hypertension, du diabète ou de la surdité. On estime qu’en agissant sur ces leviers, on pourrait prévenir jusqu’à un tiers des cas de démence. C’est considérable.
MSMV : Vous insistez souvent sur l’importance de l’humain. Pourquoi ?
Parce qu’Alzheimer ne détruit pas seulement des neurones. Elle bouleverse des vies. Derrière chaque diagnostic, il y a une personne avec ses souvenirs, ses passions, ses relations. La recherche est cruciale, mais elle ne doit pas faire oublier l’essentiel : accompagner dignement, écouter, soutenir. La maladie n’efface pas l’identité d’un patient. Elle modifie sa manière d’être au monde, mais il reste un individu avec des envies, des émotions, des besoins.
MSMV : Docteur, pourquoi est-il si important de ne pas banaliser les premiers signes d’Alzheimer ?
Parce qu’un oubli répété, une désorientation ou un changement brutal de comportement ne sont pas de simples signes du vieillissement. Ils doivent alerter. Plus le diagnostic est posé tôt, plus les solutions de prise en charge sont efficaces. Un dépistage précoce permet d’adapter les traitements, d’anticiper l’organisation familiale et de préserver plus longtemps l’autonomie du patient.
MSMV : Vers quels spécialistes faut-il se tourner après avoir consulté le médecin traitant ?
Le médecin généraliste est la première étape. Il oriente ensuite vers un neurologue ou un gériatre, selon l’âge et les symptômes. Dans la plupart des grandes villes, il existe des centres mémoire spécialisés où une équipe pluridisciplinaire établit un diagnostic précis et propose un suivi adapté.
MSMV : Comment préserver au mieux le quotidien d’un malade ?
Le quotidien doit rester le plus stable possible. Maintenir une routine, encourager les activités habituelles, valoriser ce que la personne peut encore faire… tout cela diminue l’angoisse et favorise l’autonomie. Même un petit geste, comme préparer le café ou arroser une plante, aide à préserver l’estime de soi.
MSMV : La stimulation cognitive est-elle vraiment utile ?

Oui, mais elle doit être adaptée. Jeux de mémoire, lecture, musique, jardinage… toutes ces activités sollicitent le cerveau et ralentissent le déclin. Mais il faut éviter de mettre la personne en échec. Le but est de stimuler, pas de fatiguer ni de frustrer. La stimulation doit rester un moment agréable et valorisant.
MSMV : Les aidants familiaux souffrent souvent d’épuisement. Que leur conseillez-vous ?
Un aidant qui s’épuise n’a plus la force d’aider. Il est essentiel de demander du soutien : partager la charge avec d’autres proches, solliciter les associations locales, utiliser les dispositifs d’aide à domicile. Se préserver n’est pas un luxe, c’est une condition indispensable pour continuer à accompagner son proche dans la durée.
MSMV : Quelle importance accorder à la communication avec le malade ?
Elle est centrale. Mettre des mots sur la maladie permet de briser l’isolement. Écouter, même quand les propos semblent confus, reste essentiel pour préserver la dignité. Le malade ressent plus qu’on ne le pense : un ton bienveillant, une attitude respectueuse, un regard d’attention ont souvent plus de valeur qu’un long discours.
MSMV : Quel message souhaitez-vous faire passer en cette Journée mondiale ?
Qu’Alzheimer n’est pas une fatalité silencieuse. En parler, c’est déjà agir. Chaque effort compte : celui de la recherche, celui des associations, celui des proches. Les patients nous apprennent une chose essentielle : malgré la maladie, il est possible de continuer à vivre, à créer, à aimer. Mon message est simple : ne réduisons jamais une personne à son diagnostic.
MSMV : Un dernier mot ?
Il y a 5 choses à retenir :
1. Chaque cas est unique : les symptômes et leur progression varient d’une personne à l’autre.
2. Le diagnostic évolue : de nouveaux tests sanguins simplifient et accélèrent la détection.
3. L’entourage est central : c’est lui qui détecte les premiers signes et accompagne au quotidien.
4. Des facteurs de risque sont modifiables : activité physique, alimentation équilibrée, lien social, prévention des troubles auditifs.
5. La recherche avance : de nouveaux traitements ralentissant la progression sont déjà en phase d’essai.
Mots clés : Benlefki ; Alzheimer ; cerveau ; humain ; santé ; médical ;
à lire aussi: