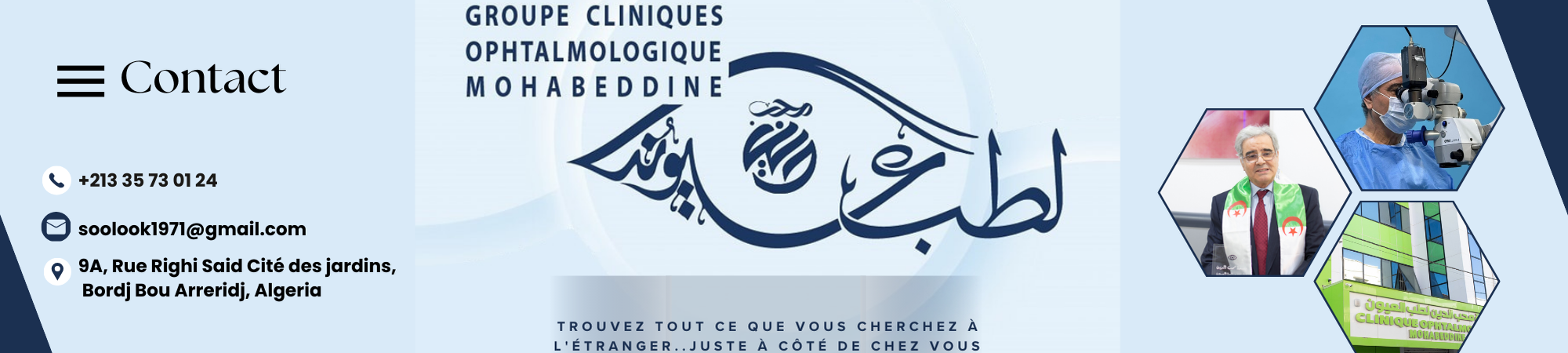Un enfant de 18 mois est mort d’une simple blessure à Gaza. Il n’est ni le premier, ni le dernier. Mais son cas, raconté avec émotion par un médecin urgentiste, illustre de manière brutale l’état de déliquescence du système de santé dans l’enclave palestinienne, alors que les bombardements, le blocus et les pénuries achèvent d’asphyxier les hôpitaux encore debout.
Depuis son arrivée dans la bande de Gaza il y a plus de deux mois, le Dr Tarek Loubani, urgentiste canadien d’origine palestinienne, affirme n’avoir jamais vu une situation aussi désespérée : « Pas un jour ne passe sans que les hôpitaux ne soient confrontés à une pénurie presque totale de sang. »
« Le sang, c’est la vie. Et quand il manque, nous sommes forcés de faire des choix inhumains. Cela revient à décider qui pourra vivre, et qui ne pourra pas », déclare-t-il, les traits marqués par la fatigue et la tension, depuis Khan Younès, au sud de Gaza.
Un enfant blessé, un sang introuvable
Parmi les cas qui le hantent, celui d’un jeune garçon d’à peine un an et demi. L’enfant avait été retrouvé seul, après un raid aérien qui avait visé une tente où s’abritait sa famille. Tous les autres occupants avaient été tués. Lui avait survécu, mais portait une petite blessure à la jambe, qui avait sectionné une artère.
« C’était une blessure localisée. Il saignait, oui, mais ce n’était en aucun cas une hémorragie fatale si l’on avait pu intervenir rapidement », se souvient le médecin. « Il était frêle, manifestement malnutri. Il lui fallait juste une transfusion. Une poche de sang aurait suffi. »
Mais dans le contexte actuel à Gaza, une simple transfusion est devenue un luxe inaccessible. En l’absence de banque de sang fonctionnelle, le don direct entre proches est souvent la seule option. Or, l’enfant était orphelin sur le coup, sans parent pour lui donner son sang.
Le personnel médical tente de trouver un donneur compatible. En vain. Et même si cela avait été possible, les médecins savaient qu’ils n’auraient pas été en mesure d’assurer les soins post-transfusionnels : ni surveillance, ni traitement, ni antibiotiques, ni pansements stériles. Tout manque.
« Ce sang aurait pu sauver un autre patient dont les chances de survie étaient plus élevées. On a donc dû prendre une décision atroce : ne rien faire, et le laisser partir. Nous étions impuissants. Et nous savions qu’il aurait pu être sauvé », confie le Dr Loubani, la voix nouée.
Gaza : quand les hôpitaux deviennent cibles

Cette tragédie individuelle survient dans un contexte d’effondrement généralisé des infrastructures médicales à Gaza. L’un des derniers événements marquants est la frappe israélienne sur une clinique de l’ONU, située à Gaza-Ville. La structure, pourtant emblématique de l’assistance humanitaire, a été touchée à plusieurs reprises depuis le début de la guerre en octobre 2023.
L’armée israélienne avait bien lancé des ordres d’évacuation dans la zone, mais n’a fourni aucune justification précise pour expliquer la frappe visant cette clinique. Israël répète que ses cibles sont des membres du Hamas ou des infrastructures militaires, mais aucune preuve n’a été fournie en l’occurrence.
La clinique faisait pourtant office de centre de soins primaires et d’abri pour des familles déplacées. Elle symbolisait ce qu’il reste d’accès aux soins pour des milliers de civils. Sa destruction n’est pas un cas isolé : de nombreux hôpitaux, ambulances, postes de secours ont été pris pour cible, réduisant à peau de chagrin l’offre médicale.
Khan Younès : l’hôpital koweïtien, à l’agonie
À Khan Younès, où exerce également le Dr Loubani, l’hôpital koweïtien tente de fonctionner malgré tout. Mais les dernières réserves médicales sont épuisées. Le Dr Suhaib al-Hams, directeur de l’établissement, lance un appel désespéré à la communauté internationale.
« L’unité de traitement des plaies est désormais fermée. Nous n’avons plus ni gazes, ni désinfectants, ni antibiotiques. Chaque jour, des centaines de blessés arrivent, beaucoup venant des centres de distribution d’aide, devenus de véritables pièges. Nous ne pouvons rien faire. »
Faute de soins, les blessures s’infectent, parfois jusqu’à entraîner des amputations ou des décès. Les complications les plus simples deviennent mortelles. Les médecins, débordés et désarmés, opèrent parfois sans anesthésie, ni matériel stérile, dans des salles d’opération plongées dans l’obscurité.
Quand soigner devient une décision politique
Dans l’ensemble du territoire, le système de santé s’est effondré. Non pas parce que les compétences manquent, mais parce que les moyens ont disparu. La guerre, les blocus, les frappes sur les infrastructures, le manque d’accès à l’électricité, à l’eau, à l’oxygène, à la logistique… tout concourt à transformer les hôpitaux en zones de survie.
Le témoignage du Dr Loubani met en lumière un dilemme cruel : dans ce contexte, chaque acte médical devient une décision stratégique. Donner du sang, utiliser un antibiotique, poser un pansement : tout cela devient une ressource à gérer comme une arme, à utiliser avec parcimonie, parce qu’il n’y en aura pas pour tout le monde.
« On ne devrait jamais avoir à décider qui mérite de vivre ou de mourir. Et pourtant, ici, c’est notre quotidien. Des enfants meurent de blessures qu’on sait parfaitement soigner. On les regarde s’éteindre. »
Une humanité abandonnée
À Gaza, la médecine ne sauve plus, elle assiste les vivants dans leur agonie. Les enfants ne meurent pas de leurs blessures, mais d’un système de soins détruit, d’un accès humanitaire empêché, d’un silence international qui confine à l’indifférence.
Le cas du petit garçon de 18 mois, mort faute d’une transfusion, n’est pas une exception. Il est le symptôme d’un effondrement médical organisé, où chaque vie compte de moins en moins. Et où le simple droit à être soigné devient une revendication politique.
Mots clés : Gaza ; hôpital ; enfant ; sang ; soins ; santé ; génocide ; médical ; droit ; soigner :
à lire aussi: