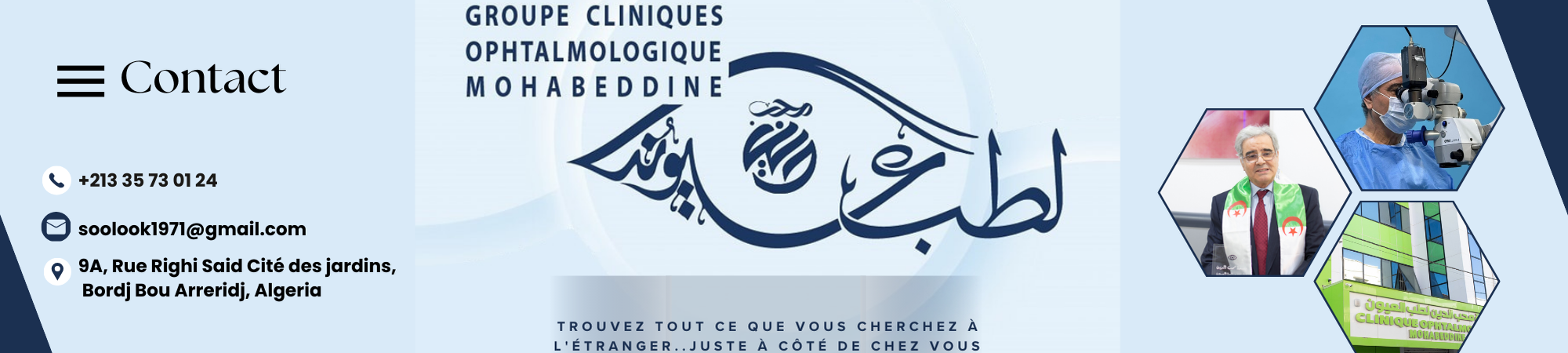Le 24 avril 2025, au Caire (Égypte), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires dont l’Algérie lancent un nouvel appel à l’unité et à l’action dans la lutte mondiale contre le paludisme. Sous le slogan ‘’Réinvestir, réimaginer et raviver nos efforts communs’’, cette campagne vise à relancer l’élan collectif, à tous les niveaux – des gouvernements aux communautés – pour accélérer les progrès vers un monde sans paludisme.
Comprendre le paludisme : un enjeu de santé mondiale
Chaque année, le 25 avril marque la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. C’est l’occasion de rappeler l’impact majeur de cette maladie évitable et guérissable, qui continue de faire des ravages, en particulier chez les enfants en Afrique subsaharienne.
Instituée en 2007 par les États membres de l’OMS, cette journée mondiale vise à renforcer la prise de conscience collective et à rappeler l’urgence d’un engagement politique et financier durable pour éradiquer le paludisme à l’échelle planétaire.
Une menace persistante pour la santé mondiale
Le paludisme reste l’une des maladies les plus meurtrières au monde. En 2023, 263 millions de nouveaux cas ont été recensés dans 83 pays, contre 252 millions en 2022. Cette progression met en lumière une stagnation préoccupante dans la lutte contre cette maladie.
Depuis 2015, la tendance est à la hausse, alors même que des objectifs ambitieux avaient été fixés pour 2025 et 2030. Bien que des efforts importants aient permis d’éviter 2,2 milliards de cas et 12,7 millions de décès depuis 2000, le rythme actuel des avancées est insuffisant pour atteindre l’élimination.
Une maladie ancienne, toujours meurtrière
Le paludisme est une maladie parasitaire provoquée par le Plasmodium, un protozoaire transmis à l’homme par la piqûre du moustique femelle Anophèle.
Découvert en 1880, ce parasite n’a jamais cessé de frapper. Chaque année, le paludisme infecte près de 300 millions de personnes dans le monde et provoque plus d’un million de décès, dont la majorité concerne les enfants de moins de 5 ans.
Bien que les progrès scientifiques soient notables, cette maladie reste une urgence de santé publique, en particulier dans les zones tropicales à faibles ressources sanitaires.
L’Afrique, épicentre de l’épidémie
Le continent africain reste le plus durement touché. En 2023, 80 % des cas et 94 % des décès évités l’ont été en Afrique. Cela reflète la concentration de la charge de morbidité sur ce continent, mais aussi l’efficacité des actions ciblées menées sur place.
Au Soudan, la situation est critique. Le pays détient le taux d’incidence le plus élevé de la Région Méditerranée orientale. En 2023, plus de 3,4 millions de cas et près de 7900 décès y ont été enregistrés, bien que ces chiffres soient probablement sous-estimés à cause des conflits armés qui freinent la surveillance et les soins.
Conflits, inondations, instabilité : des obstacles multiples
Plusieurs facteurs aggravent la situation dans la région :
– Inondations dévastatrices au Pakistan entre 2021 et 2023 ont engendré 3,7 millions de cas supplémentaires.
– Les conflits armés au Soudan et au Yémen perturbent gravement les programmes de prévention.
– L’instabilité politique empêche de mettre en œuvre des actions continues et coordonnées.
Un défi évolutif : résistances et changement climatique

Le combat devient plus complexe avec l’émergence de résistances aux médicaments antipaludiques et aux insecticides, ainsi qu’avec l’impact du réchauffement climatique, qui modifie les zones de reproduction des moustiques et les cycles de transmission.
Ces changements exigent de repenser les stratégies. L’arsenal actuel de lutte – moustiquaires imprégnées, pulvérisation, traitement préventif – doit être renforcé par des solutions innovantes.
Des signes d’espoir et d’innovation
Malgré les défis, plusieurs pays enregistrent des avancées significatives :
– En octobre 2024, l’Égypte a été déclarée exempte de paludisme par l’OMS, rejoignant les Émirats arabes unis (2007) et le Maroc (2010).
– Djibouti a lancé une initiative pionnière en 2024 en introduisant à titre expérimental des moustiques génétiquement modifiés (Anophelesstephensi) pour enrayer la transmission.
– Au Soudan, un programme de vaccination antipaludique a été lancé en novembre 2024. Objectif : atteindre 1,3 million d’enfants dans les zones les plus touchées d’ici 2026.
Une approche régionale coordonnée
Face aux risques de réintroduction, l’OMS travaille avec le GLIDE (Global Institute for Disease Elimination) pour renforcer la prévention dans toute la Méditerranée orientale, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
Des outils de surveillance, comme le réseau HANMAT, permettent de détecter et de contrer :
– La résistance aux traitements
– Les mutations rendant les tests de diagnostic inefficaces
– La diffusion de moustiques vecteurs invasifs
Le « Big Push » : six leviers pour relancer les progrès
L’OMS appelle à un sursaut collectif autour de six axes majeurs :
1. Mieux coordonner les efforts entre les partenaires nationaux et internationaux.
2. Renforcer le leadership local avec une approche inclusive.
3. Optimiser l’utilisation des données pour guider les actions.
4. Améliorer la couverture et la qualité des interventions existantes.
5. Développer des outils de rupture (vaccins, biotechnologies) et les déployer rapidement.
6. Augmenter les financements avec une stratégie durable et multisectorielle.
Un avenir plus sûr est possible
Mettre fin au paludisme, c’est éviter des millions de décès, soulager les systèmes de santé et libérer des ressources économiques. Chaque moustiquaire distribuée, chaque enfant vacciné, chaque donnée collectée est un pas vers un avenir plus équitable, plus résilient et plus sain. « Le paludisme est évitable et guérissable. L’éliminer, c’est investir dans un futur plus sûr pour toutes les nations », déclare la DreHananBalkhy, directrice régionale de l’OMS.
Une leçon de l’histoire Dans les années 1960, des avancées majeures avaient été enregistrées. Mais l’arrêt brutal des efforts mondiaux en 1969 a conduit à un retour massif de la maladie. Il a fallu 30 ans pour relancer la mobilisation. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus nous permettre une telle régression.
Prévenir, éduquer, protéger
La lutte contre le paludisme ne se limite pas aux médicaments. La prévention et l’éducation communautaire sont essentielles pour casser la chaîne de transmission.
Informer les populations sur l’importance des moustiquaires, sur les symptômes à surveiller, et sur la nécessité d’un traitement précoce permet non seulement de sauver des vies, mais aussi de réduire durablement la propagation de la maladie.
Des programmes éducatifs ciblés, en milieu scolaire et communautaire, renforcent ces efforts de prévention, notamment dans les zones rurales à forte endémie.
Une alliance mondiale : ‘’Faire reculer le paludisme’’

Depuis 1998, le partenariat mondial ‘’Faire reculer le paludisme’’ réunit des acteurs clés de la santé mondiale : l’OMS, l’UNICEF, la Banque mondiale, le PNUD, ainsi que de nombreux gouvernements, ONG et entreprises.
Objectif : coordonner les stratégies, mutualiser les ressources, et amplifier l’impact des actions de prévention, de traitement et de sensibilisation.
Ce partenariat a notamment permis de mobiliser l’industrie pharmaceutique et les bailleurs internationaux pour soutenir le développement et la distribution de médicaments antipaludiques innovants, accessibles aux populations les plus vulnérables.
Une décision collective
Nous savons ce qu’il faut faire. Les outils existent. Les connaissances sont là. Il reste à réinvestir dans ce combat, réimaginer nos stratégies face aux nouveaux défis, et raviver notre engagement collectif pour que plus personne ne meure du paludisme.
Un monde sans paludisme est possible. Mais il ne le sera que si nous agissons maintenant.
Mots clés : santé ; mondiale ; paludisme ; OMS ; Afrique ; moustique ; sensibilisation ;