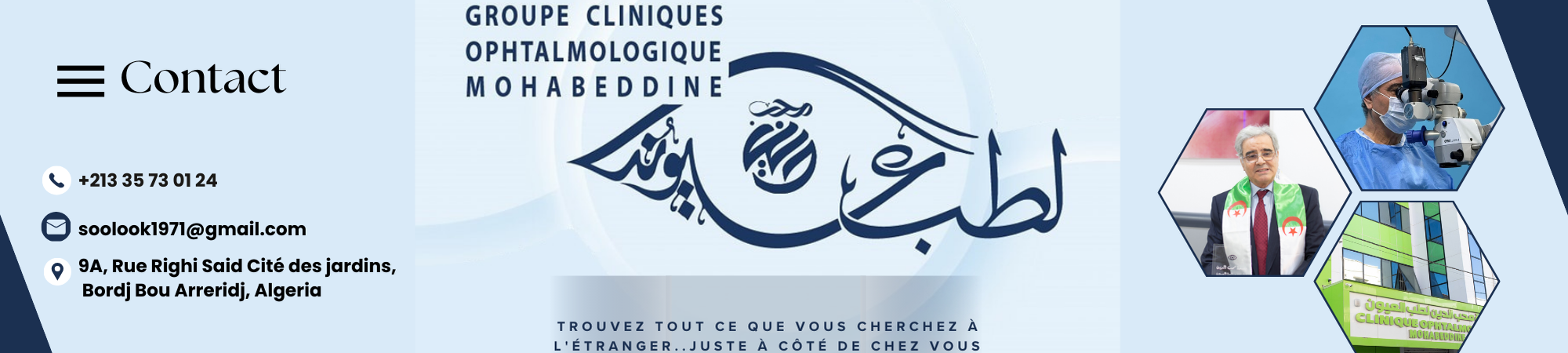Aussi appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA), la maladie de Charcot est une pathologie neurodégénérative grave qui détruit progressivement les motoneurones, ces cellules nerveuses responsables du contrôle des muscles volontaires. Cette atteinte entraîne, au fil du temps, une paralysie progressive des membres, des troubles de la parole, puis de la respiration.
Une maladie rare, redoutable et encore sans traitement
Chaque individu présente un risque d’environ 1 sur 300 de développer la maladie au cours de sa vie. Selon une étude mondiale de référence, la prévalence moyenne de la SLA est estimée à 4,4 cas pour 100 000 habitants. En 2015, environ 222 800 personnes vivaient avec cette pathologie dans le monde, un chiffre qui pourrait atteindre près de 376 700 d’ici 2040, selon les projections épidémiologiques.
En Algérie, l’absence de registre national rend difficile une estimation précise du nombre de patients atteints. Toutefois, certaines études régionales — notamment dans la wilaya de Tlemcen — ont recensé 41 cas sur une période donnée, illustrant la nécessité de renforcer la surveillance épidémiologique et la collecte de données nationales sur cette maladie encore méconnue.
SLA : les premiers signes discrets d’une maladie implacable
Les premiers signes apparaissent souvent de façon insidieuse : faiblesses dans les mains, crampes, tremblements musculaires ou fasciculations. Peu à peu, la motricité se dégrade, jusqu’à atteindre la parole, la déglutition et la respiration.
La maladie n’est pas douloureuse, mais elle handicape profondément la vie quotidienne et demeure, à ce jour, incurable.
Une recherche internationale pour comprendre l’origine

Depuis des décennies, la communauté scientifique tente de percer les mystères de cette affection. Les recherches se sont longtemps concentrées sur les causes neurologiques et génétiques connues — notamment les mutations dans certains gènes comme SOD1 ou C9orf72 — mais ces explications ne concernent qu’une minorité de cas.
En effet, 90 % des malades développent une forme dite “sporadique”, sans antécédent familial. C’est précisément sur ces cas que se sont penchés des chercheurs chinois, avec une approche novatrice : l’analyse de l’ADN mitochondrial.
L’ADN mitochondrial : un suspect inattendu
Les scientifiques ont séquencé l’ADN mitochondrial d’une quarantaine de patients atteints de SLA. Contrairement à l’ADN du noyau cellulaire, l’ADN mitochondrial — hérité exclusivement de la mère — régit la production d’énergie dans les cellules.
Selon les résultats de cette étude, publiés récemment, certaines mutations du complexe respiratoire mitochondrial IV, un groupe de protéines essentielles à la respiration cellulaire, pourraient être impliquées dans la dégénérescence des motoneurones. « Ces défauts d’origine énergétique fragiliseraient les neurones moteurs, jusqu’à provoquer leur mort progressive », expliquent des spécialiste de la maladie de Charcot.
Avec l’âge, l’ADN mitochondrial devient plus vulnérable aux mutations, exposant certains individus à un risque accru de développer la maladie, même sans prédisposition génétique initiale.
Des résultats prometteurs, mais à confirmer
Cette découverte ne constitue pas encore une certitude. Les chercheurs appellent à la prudence scientifique. « Il faut d’abord confirmer que les mutations identifiées sont bien à l’origine de la maladie », soulignent-ils.
Des études complémentaires, sur des cohortes plus larges, sont nécessaires pour valider le lien de causalité entre ces anomalies mitochondriales et la SLA.
Mais cette piste offre déjà un nouvel horizon de recherche pour comprendre la forme la plus fréquente et la moins expliquée de la maladie.
Vers une nouvelle stratégie thérapeutique
Si les mutations mitochondriales s’avèrent confirmées, il resterait à identifier précisément les gènes fautifs — une tâche complexe. Ces anomalies varient d’un patient à l’autre, ce qui rend difficile la conception d’un traitement unique.
L’enjeu est donc de repérer des mécanismes biologiques communs, appelés voies de signalisation, qui seraient altérés dans tous les cas. Et sur ce point, les chercheurs disposent déjà d’une piste encourageante : la protéine CREB3, impliquée dans la régulation de l’expression des gènes neuronaux.
Des expériences ont montré que stimuler cette protéine pourrait ralentir la mort des motoneurones.
Mieux encore, certains patients porteurs d’un variant naturel de CREB3 (R119G) voient leur maladie évoluer plus lentement. « Ce variant augmente la capacité protectrice de la protéine sur les neurones », expliquent les chercheurs.
Cette observation ouvre la voie à une nouvelle approche thérapeutique : activer pharmacologiquement CREB3 pour protéger les neurones.
Des recommandations pour les patients et les proches
En attendant l’émergence d’un traitement, les spécialistes insistent sur plusieurs mesures pour mieux accompagner les malades :
- Suivi neurologique régulier dans un centre expert SLA.
- Rééducation motrice et orthophonique pour maintenir la mobilité et la communication.
- Soutien nutritionnel et respiratoire dès les premiers signes de dégradation.
- Accompagnement psychologique pour les patients et leurs proches, souvent durement touchés par la progression rapide de la maladie.
- Participation à la recherche clinique, essentielle pour faire avancer la compréhension de la maladie.
L’espoir d’une médecine plus ciblée
La découverte du rôle possible de l’ADN mitochondrial marque une étape clé dans la compréhension de la maladie de Charcot.
Elle illustre l’importance de la médecine génomique et de l’intelligence artificielle dans la détection de mutations rares et la prédiction des réponses aux traitements.
À terme, ces avancées pourraient permettre une médecine personnalisée, capable d’adapter les thérapies à chaque profil génétique. « Chaque découverte rapproche un peu plus les chercheurs d’un futur traitement, et chaque patient d’un espoir renouvelé », concluent-ils.
La maladie de Charcot reste aujourd’hui une épreuve humaine et scientifique. Mais les progrès récents rappellent qu’en biologie, même les plus petites séquences d’ADN peuvent changer le destin d’une vie.
Mots clés : maladie ; Charcot ; scientifique ; biologie ; ADN ; neurones ;
à lire aussi: