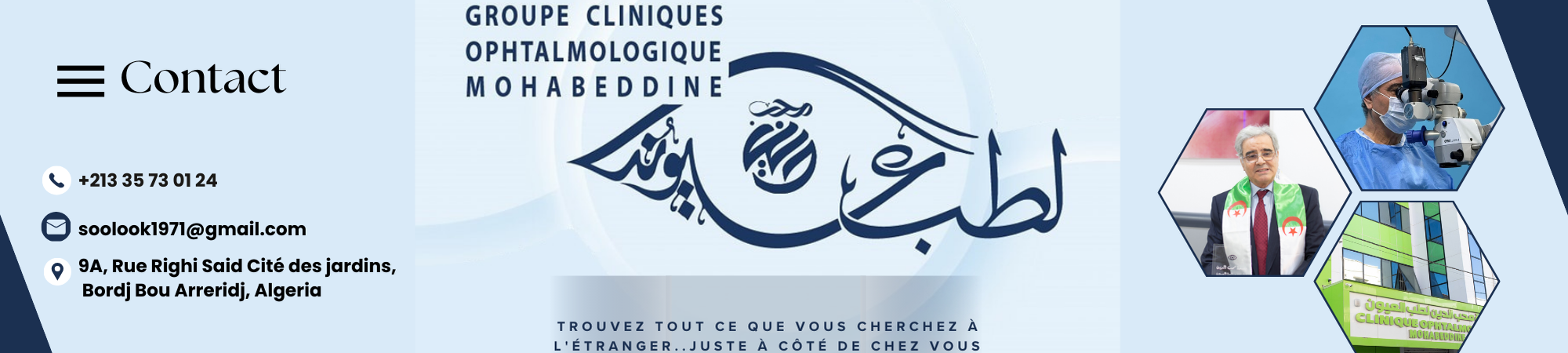Chaque année, le 21 septembre marque un rendez-vous mondial majeur : la Journée de la maladie d’Alzheimer. Plus qu’une date symbolique, c’est un moment de mobilisation collective, de réflexion et d’action face à une pathologie qui bouleverse la vie de millions de personnes et de leurs familles.
Cet événement, initié en 1994 par l’OMS et Alzheimer’s Disease International (ADI), poursuit un objectif clair : briser le silence, informer le grand public, soutenir les malades et leurs proches, tout en encourageant la recherche scientifique.
Une journée pour sensibiliser et agir
Les manifestations organisées à travers le monde sont multiples : conférences médicales, campagnes de sensibilisation, initiatives associatives, débats publics. Toutes poursuivent un but commun : mieux faire connaître la maladie et ses répercussions, lutter contre la stigmatisation et plaider pour une meilleure prise en charge.
Les objectifs de cette journée sont multiples :
- Informer sur les symptômes et leurs conséquences.
- Lutter contre les préjugés et l’isolement social.
- Soutenir la recherche scientifique, en particulier sur les traitements innovants.
- Encourager les politiques de santé publique adaptées aux besoins des patients.
- Accompagner les aidants familiaux, dont le rôle reste essentiel.
Quelques chiffres clés
- La maladie d’Alzheimer est la première cause de démence dans le monde, représentant 60 à 70 % des cas.
- En 2020, on dénombrait 55 millions de personnes atteintes de démence ; ce chiffre pourrait tripler d’ici 2050.
- En Algérie, 200 000 personnes vivent avec Alzheimer, et ce nombre ne cesse d’augmenter.
- Chaque année, près de 10 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués dans le monde.
- Le coût économique mondial de la démence est estimé à plus de 1 300 milliards de dollars par an.
Comprendre au-delà d’Alzheimer
Lorsqu’on évoque la démence, le réflexe est immédiat : penser à Alzheimer. Pourtant, un patient sur cinq vivant avec une démence n’en est pas atteint.
Les médecins parlent désormais de maladies neurocognitives. Ce terme englobe un large spectre de pathologies qui perturbent progressivement nos fonctions intellectuelles : mémoire, langage, raisonnement, organisation, perception. Ces maladies peuvent aussi entraîner des troubles comportementaux ou des difficultés motrices, parfois bien avant l’apparition des troubles de la mémoire.
Les formes sont diverses :
- Dégénérescences frontotemporales, souvent marquées par des troubles du comportement.
- Démence à corps de Lewy, caractérisée par des hallucinations et des fluctuations cognitives.
- Démence parkinsonienne, où les symptômes moteurs précèdent les troubles cognitifs.
Reconnaître cette diversité permet un diagnostic plus précis et une prise en charge adaptée.
Alzheimer, la plus fréquente mais pas toujours typique

Avec près d’un million de cas en France, Alzheimer reste la plus répandue. Elle est liée à l’accumulation anormale de deux protéines dans le cerveau : les plaques amyloïdes et la protéine tau. Ces dépôts entraînent la mort progressive des neurones.
Le premier signe est souvent la perte de mémoire à court terme : oublis répétés, questions posées plusieurs fois, difficulté à retenir des événements récents. Mais réduire Alzheimer à de simples oublis est une erreur. La maladie peut également toucher :
- Le langage (difficulté à trouver ses mots).
- L’orientation (se perdre dans un lieu familier).
- Le jugement (prendre des décisions inadaptées).
- Le comportement (anxiété, apathie, irritabilité).
Avec le temps, l’autonomie se réduit et la dépendance s’installe, rendant le rôle des proches et des aidants d’autant plus crucial.
Vivre avec Alzheimer : témoignages
Derrière les diagnostics, il y a des vies, des visages et des histoires.
Saïd, 64 ans, diagnostiqué il y a quelques années, témoigne : « Je vis au quotidien avec la maladie de manière quasiment normale. Quelqu’un qui me croise dans la rue ne devine rien. »
Pour lui, rester actif et continuer à avoir des projets est essentiel. Voyager, jouer de la musique, du puzzle, cultiver ses passions : autant d’ancrages qui permettent de garder une qualité de vie.
Hakima, 60 ans, a trouvé dans la peinture un refuge : « Quand je peins, j’oublie mes soucis. La peinture, la lecture, l’écriture, c’est l’accès à l’imaginaire. Et ça, on ne peut pas nous le voler. »
Ces récits rappellent que, malgré la maladie, il est possible de rester acteur de sa vie et de trouver des ressources personnelles pour avancer.
Où en est la recherche ?
Si aucun traitement curatif n’existe à ce jour, la recherche progresse rapidement. Les axes prioritaires sont :
- Le diagnostic précoce, grâce à l’imagerie cérébrale et aux biomarqueurs.
- La compréhension des mécanismes biologiques de la maladie.
- Le développement de nouveaux médicaments, comme les immunothérapies.
- Les thérapies non médicamenteuses : stimulation cognitive, activité physique, art-thérapie.
- La prévention : lutte contre les facteurs de risque (sédentarité, isolement, hypertension, diabète, troubles auditifs…).
Des organisations internationales financent de nombreux projets, convaincus qu’un avenir sans Alzheimer est possible grâce à l’alliance entre science, solidarité et engagement citoyen.
Une cause qui nous concerne tous
La Journée mondiale Alzheimer 2025 n’est pas seulement un moment d’information scientifique. Elle est aussi un appel à la solidarité. La maladie ne touche pas seulement les patients : elle bouleverse aussi les familles, les aidants, la société entière.
Informer, comprendre et agir, c’est redonner de la dignité aux personnes concernées, c’est aussi préparer un avenir où les malades ne seront plus définis par leurs pertes, mais par leurs capacités préservées et leur humanité.
Mots clés : Alzheimer ; cerveau ; santé ; soins ; informer ; démence ;
à lire aussi: