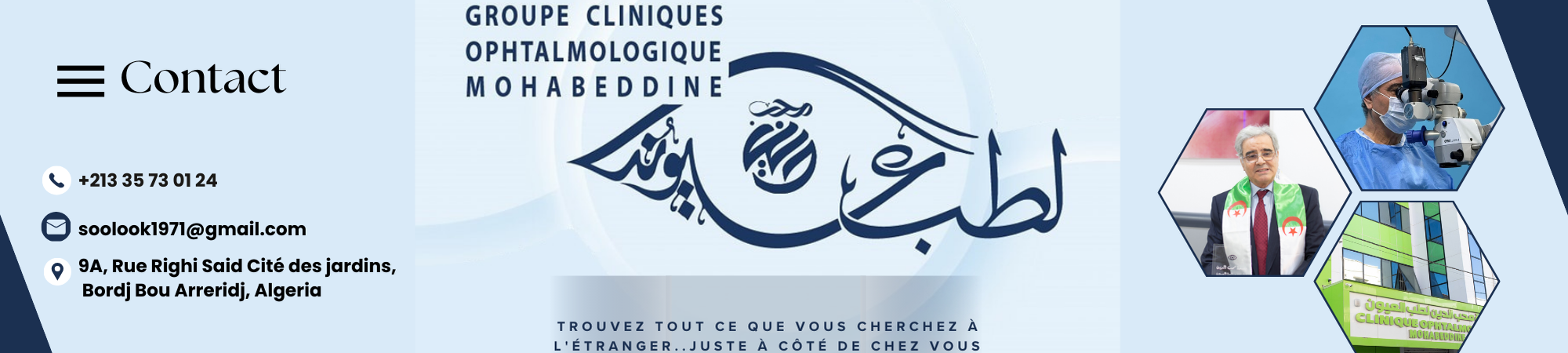Récemment décrit, le syndrome VEXAS (« Vacuoles, enzyme E1, lié au chromosome X, auto-inflammatoire, et mutations somatiques ») bouleverse le paysage des maladies auto-inflammatoires acquises. Identifié en 2020, ce syndrome repose sur une mutation somatique du gène UBA1, situé sur le chromosome X, et touche majoritairement les hommes de plus de 50 ans. Sa physiopathologie complexe et son tableau clinique polymorphe en font un enjeu majeur pour la communauté médicale.
Une mutation génétique à l’origine d’une inflammation incontrôlée
Le syndrome VEXAS se distingue par une mutation acquise du gène UBA1, essentiel au système ubiquitine-protéasome, impliqué dans la dégradation des protéines intracellulaires. Cette anomalie génétique entraîne un stress cellulaire majeur et une inflammation persistante. Contrairement à de nombreuses maladies génétiques décrites par un phénotype clinique, le VEXAS a été identifié grâce à une approche génotypique novatrice, à partir de patients présentant des symptômes inflammatoires inexpliqués.
Un spectre de manifestations variées
Le tableau clinique du syndrome VEXAS inclut des épisodes récurrents de fièvre, des dermatoses neutrophiliques douloureuses, des atteintes pulmonaires (dyspnée, opacités radiologiques), des chondrites (notamment du nez et des oreilles) ainsi que des complications thrombotiques prédominamment veineuses. Une atteinte hématologique est fréquemment observée sous forme d’une anémie macrocytaire, d’une thrombopénie ou d’un syndrome myélodysplasique associé à des vacuoles dans les cellules précurseurs de la moelle osseuse.
Un diagnostic moléculaire indispensable
Le diagnostic repose sur l’identification d’une mutation du gène UBA1 par des techniques de séquençage génétique (Sanger ou NGS). Il est indiqué chez les patients présentant un tableau inflammatoire chronique inexpliqué associé à une macrocytose et une cytopénie.
Une prise en charge encore en développement
En l’absence de recommandations standardisées, la prise en charge est empirique. Les corticoïdes représentent le traitement de première ligne, bien que souvent associés à une forte dépendance. Des biothérapies ciblant les cytokines pro-inflammatoires, notamment le tocilizumab (anti-IL-6) et les inhibiteurs de JAK, ont montré une certaine efficacité. Pour les patients atteints de manifestations hématologiques sévères, des agents hypométhylants comme l’azacitidine et l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques représentent des alternatives thérapeutiques prometteuses.
Vers de nouvelles recommandations
Avec une prévalence estimée à 1 pour 4 000 chez les hommes de plus de 50 ans, le syndrome VEXAS est probablement sous-diagnostiqué. Des travaux internationaux sont en cours pour affiner les critères diagnostiques et élaborer des protocoles thérapeutiques standardisés, en intégrant les avancées récentes en génétique et en immunologie.
Conclusion
Le syndrome VEXAS illustre les progrès de la médecine de précision et l’importance des approches génomiques dans l’identification de nouvelles maladies auto-inflammatoires. Son diagnostic repose sur des critères génétiques, et sa prise en charge est en constante évolution. Des études prospectives seront nécessaires pour déterminer les stratégies thérapeutiques les plus efficaces et améliorer le pronostic des patients.
Mots-clés :
Anémie macrocytaire ; Auto-inflammation ; Biothérapies ; Chondrites ; Corticoïdes ; Diagnostic génétique ; Fièvre récurrente ; Inflammation chronique ; Inhibiteurs de JAK ; Mutation UBA1 ; Syndrome myélodysplasique ; Syndrome VEXAS.
Bibliographie succinte :
- Beck DB, Ferrada MA, Sikora KA, et al. Somatic mutations in UBA1 and severe adult-onset autoinflammatory disease. N Engl J Med 2020;383(27):2628‑38.
- Georgin-Lavialle S, Terrier B, Guedon AF, et al. Further characterization of clinical and laboratory features in VEXAS syndrome: Large-scale analysis of a multicentre case series of 116 French patients. Br J Dermatol 2022;186(3):564-74.
- Koster MJ, Lasho TL, Olteanu H, et al. VEXAS syndrome: Clinical, hematologic features and a practical approach to diagnosis and management. Am J Hematol 2024;99(2):284-99.