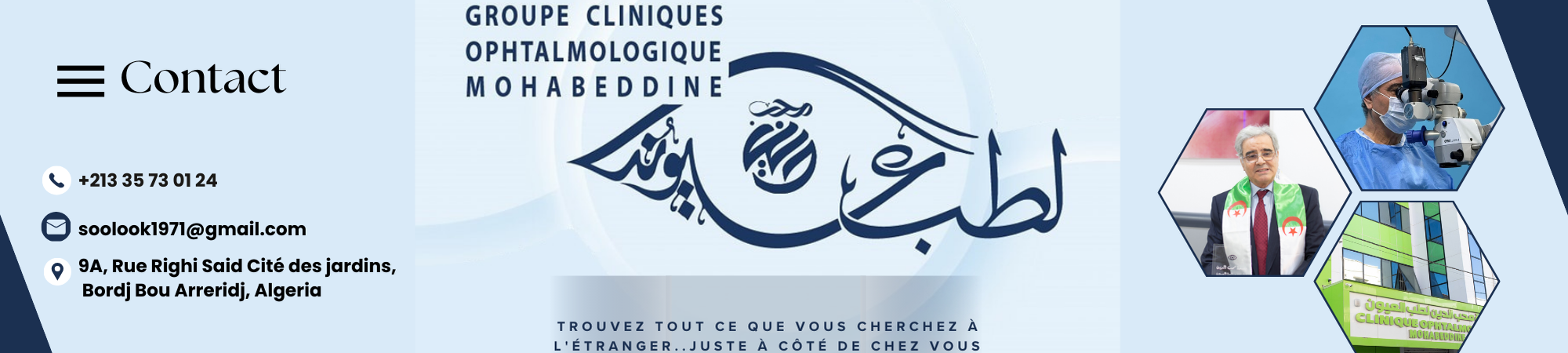L’Oxford University Press, éditeur du dictionnaire de référence de la langue anglaise, a désigné le terme “brain rot” comme mot de l’année 2024. Littéralement traduit par ‘’pourriture cérébrale’’, cette expression décrit les effets néfastes sur la santé mentale des utilisateurs d’Internet, résultant de la consommation excessive de contenus de faible qualité sur les réseaux sociaux. Bien que le terme ne corresponde pas à une pathologie médicale officielle, il reflète une détérioration supposée de l’état mental des individus, particulièrement ceux exposés de manière prolongée à des contenus peu stimulants. L’usage croissant de cette expression par les internautes invite à une réflexion sur les impacts de la surconsommation numérique.
Il s’agit d’un phénomène qui touche une large population, notamment les jeunes, qui passent un temps considérable à scroller sur leurs téléphones.
Une définition selon Oxford
L’Université d’Oxford définit le ’’brain rot’’ comme « la détérioration supposée de l’état mental ou intellectuel d’une personne, particulièrement en raison de la consommation excessive de contenus perçus comme triviaux ou peu stimulants, notamment sur Internet ». Ce terme désigne aussi des activités ou des contenus susceptibles de causer cette détérioration. Il est particulièrement associé à la consommation de vidéos et de publications répétitives et peu enrichissantes sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou encore YouTube.
Un symptôme de notre époque
Andrew Przybylski, psychologue et professeur à l’Université d’Oxford, souligne que l’essor du terme ‘’brain rot ‘’ est un reflet de notre époque. Selon lui, il incarne parfaitement les effets de la surconsommation de contenus numériques, souvent vus comme peu stimulants sur le plan intellectuel, qui ont un impact négatif sur la santé mentale des utilisateurs, particulièrement chez les jeunes. Le ‘’brain rot’’ devient ainsi un symptôme de notre addiction à des contenus rapides et faciles à consommer, mais qui ne font pas appel à une réflexion profonde. Pour Przybylski, c’est un phénomène bien ancré dans le monde moderne, où le temps d’attention des individus se raccourcit constamment.
Une expression ancienne avec une portée nouvelle
Bien que l’expression semble moderne et directement liée aux réseaux sociaux, elle trouve ses racines dans le XIXe siècle. C’est le philosophe américain Henry David Thoreau, dans son ouvrage ‘’Walden’’, qui évoque pour la première fois la notion de « pourriture cérébrale ». Thoreau critiquait déjà la tendance de la société à se détourner des idées profondes et des efforts intellectuels, et ce, bien avant l’avènement des technologies modernes. Il écrivait : « Alors que l’Angleterre se bat pour éradiquer la pourriture de la pomme de terre, qui s’attaquerait à la pourriture cérébrale, bien plus répandue et dangereuse ? »
La montée en popularité du terme

En 2024, l’utilisation du terme ‘’brain rot’’ a connu une augmentation spectaculaire, avec une hausse de 230 % par rapport à l’année précédente. Cette popularité est directement liée à l’inquiétude croissante concernant l’impact des réseaux sociaux et des contenus numériques de faible qualité. Selon Oxford Languages, « nos experts ont observé que l’expression a pris de l’ampleur pour décrire l’inquiétude grandissante liée à l’effet de la consommation excessive de contenus numériques peu stimulants ». Ce phénomène est surtout remarqué dans les discussions autour de l’impact des réseaux sociaux sur le bien-être des utilisateurs.
Un humour décalé et une prise de conscience
Pour beaucoup de jeunes utilisateurs, les contenus qualifiés de ‘’brain rot’’ ne sont pas perçus négativement, mais comme une forme d’humour décalé ou une manière d’exprimer une forme de catharsis face à la surconsommation de contenu. Pour eux, ces contenus peuvent être vus comme des divertissements légers, souvent ridicules, mais permettant de se déconnecter des préoccupations sérieuses. Ce phénomène de “l’humour absurde” ou du ‘’même’’ (souvent des vidéos humoristiques ou des montages) fait partie intégrante de l’expérience des utilisateurs de réseaux sociaux. Pourtant, malgré l’usage décontracté du terme, il existe un sous-texte de prise de conscience des effets secondaires négatifs sur la santé mentale, ce qui est particulièrement perceptible chez les jeunes générations.
Une analyse de l’adoption du terme par les jeunes générations
L’attrait pour le terme ‘’brain rot’’ chez les jeunes générations, comme la génération Z et la génération Alpha, témoigne d’une auto-réflexion un peu décalée. Selon Casper Grathwohl, directeur de la maison d’édition Oxford Languages, il est fascinant de voir comment ces générations, créatrices et consommatrices de contenu numérique, ont adopté ce terme. Selon lui, cela montre « une prise de conscience presque effrontée des conséquences négatives de l’utilisation des réseaux sociaux ». Il s’agit d’une forme d’ironie consciente, où les jeunes sont conscients des effets nuisibles de leur propre comportement numérique tout en l’acceptant parfois comme une forme d’humour.
Le “brain rot” comme phénomène culturel et social
Le terme’’ brain rot’’ va au-delà d’une simple critique des réseaux sociaux. Il est devenu une sorte de symbole culturel, une façon de nommer une expérience commune dans une société où l’accès constant à Internet, aux vidéos courtes et aux publications rapides est devenu une norme. Si le terme est en effet perçu comme une dénonciation de l’impact des technologies sur nos cerveaux, il reflète aussi une acceptation tacite de ces dérives, avec parfois un détachement ironique face à l’inévitable.
Une prise de conscience collective
Le ‘’brain rot’’ n’est pas seulement un terme de critique, mais aussi un indicateur des préoccupations contemporaines concernant l’impact des réseaux sociaux et de la surconsommation numérique sur la santé mentale. Il traduit une prise de conscience collective, notamment chez les jeunes générations, des effets délétères d’une consommation excessive et parfois superficielle de contenus. À la fois symptôme et phénomène culturel, il est l’illustration de l’époque numérique dans laquelle nous vivons, où l’humour et la réflexion sur les dangers de la technologie s’entrelacent.
Mots clés : brain rot ; humour ; surconsommation ; numérique ; mental ; détérioration ;