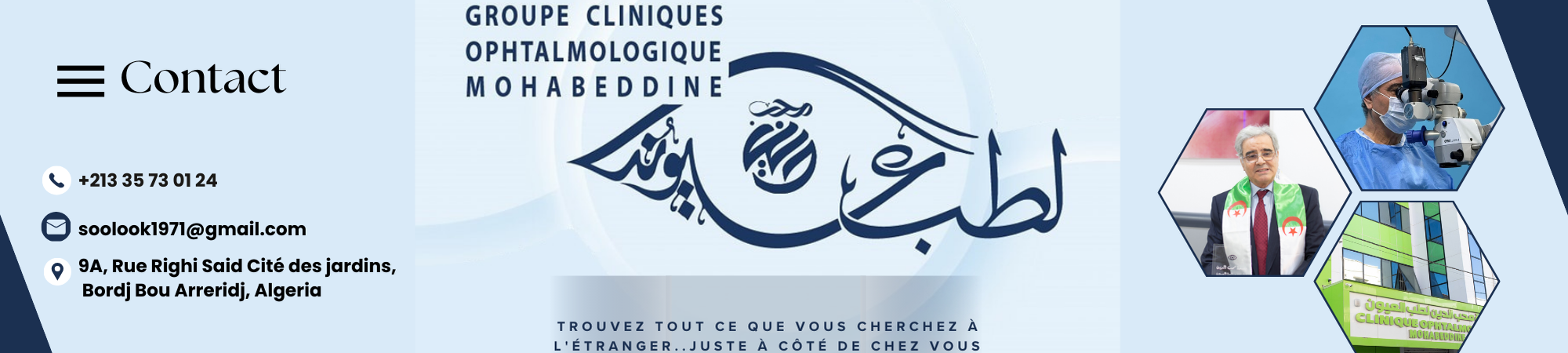Une vaste étude parue dans Nature Cardiovascular Research révèle que les femmes souffrant du syndrome prémenstruel (SPM) présentent un risque significativement plus élevé de maladies cardiovasculaires, en particulier lorsqu’elles sont diagnostiquées jeunes ou qu’elles présentent des antécédents psychiatriques postnataux. Ces résultats ouvrent une nouvelle voie dans la compréhension du lien entre troubles hormonaux et santé cardiovasculaire féminine.
Le SPM : un déséquilibre hormonal complexe
Le syndrome prémenstruel survient au cours de la phase lutéale du cycle menstruel, soit après l’ovulation et avant les règles. Cette période est marquée par une baisse rapide du taux de progestérone et une relative prédominance des œstrogènes. Ces fluctuations hormonales peuvent avoir un effet délétère sur le système nerveux central, mais aussi sur le système cardiovasculaire.

Sur le plan physiopathologique, on observe :
- Une sensibilité accrue aux variations hormonales chez certaines femmes, notamment au niveau des récepteurs à la progestérone et à la sérotonine.
- Des déséquilibres neurochimiques (notamment dans les voies sérotoninergiques et GABAergiques) qui influencent les émotions, la perception de la douleur, et même la régulation vasculaire.
Un impact sur le système nerveux autonome
Le SPM pourrait aussi perturber le système nerveux autonome, qui contrôle les fonctions involontaires comme la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Des études antérieures ont montré que certaines femmes avec SPM ont :
- Une réduction du tonus vagal (tonus parasympathique), associé à une plus grande réactivité au stress.
- Une augmentation de la réponse sympathique, qui peut favoriser l’hypertension, les palpitations et les arythmies.
Inflammation, tension artérielle et coagulation
Trois mécanismes majeurs semblent expliquer le sur-risque cardiovasculaire :
1. Inflammation chronique de bas grade
Les femmes avec SPM présentent souvent des taux plus élevés de cytokines inflammatoires, comme l’IL-6, la TNF-alpha ou la CRP (protéine C-réactive). Ces marqueurs sont impliqués dans l’athérogenèse, c’est-à-dire dans la formation de plaques d’athérome qui obstruent les artères.
2. Altérations de la régulation tensionnelle
Des perturbations du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) peuvent se traduire par une rétention hydrosodée, une élévation de la pression artérielle, et une réduction de la fonction endothéliale, altérant la dilatation naturelle des vaisseaux.
3. Troubles de la coagulation et du métabolisme
Le SPM pourrait être associé à une augmentation de la coagulabilité sanguine (hypercoagulabilité) et à des anomalies métaboliques, comme une résistance à l’insuline ou un profil lipidique déséquilibré (hausse du LDL-cholestérol, baisse du HDL), qui sont autant de facteurs de risque d’AVC ou d’infarctus.
Résultats de l’étude : une alerte sérieuse
Sur plus de 99 000 femmes suivies jusqu’à 22 ans, les chercheurs ont observé :
- Un risque global de maladie cardiovasculaire augmenté de 10 %.
- Un risque d’arythmie cardiaque supérieur de 31 %.
- Un risque d’AVC ischémique accru de 27 %.
Ces risques sont présents même après ajustement pour les facteurs confondants classiques (IMC, tabac, antécédents familiaux, santé mentale).
Qui sont les femmes les plus exposées ?
Deux profils particulièrement vulnérables émergent :
1. Les femmes diagnostiquées avec un SPM avant l’âge de 25 ans, période où les systèmes hormonaux et cardiovasculaires sont encore en phase de stabilisation.
2. Celles ayant souffert de dépression postnatale, elle aussi liée à des variations hormonales brutales et à une vulnérabilité accrue aux changements neuroendocriniens.
Ces femmes présentent probablement une hypersensibilité hormonale systémique, avec une capacité d’adaptation physiologique réduite, notamment face aux fluctuations œstroprogestatives du cycle.
Enjeux cliniques : vers un dépistage cardiovasculaire ciblé ?
Cette étude suggère que le SPM pourrait être utilisé comme indicateur précoce d’un terrain cardiovasculaire à risque. Les gynécologues et médecins généralistes devraient :
- Intégrer le SPM dans l’évaluation globale du risque cardiovasculaire féminin.
- Surveiller la tension artérielle, le profil lipidique, la glycémie et l’inflammation chez ces patientes.
- Encourager une hygiène de vie adaptée (alimentation anti-inflammatoire, activité physique, gestion du stress).
Le rôle des traitements : au-delà des symptômes
Les traitements actuels du SPM visent d’abord à soulager les symptômes, mais ils pourraient aussi prévenir les complications cardiovasculaires, en particulier s’ils réduisent l’inflammation ou régulent les réponses hormonales et neurovégétatives :
- ISRS (fluoxétine, sertraline) : stabilisent la sérotonine et peuvent diminuer la réponse au stress.
- Traitements hormonaux combinés : régulent les variations cycliques du taux de progestérone.
- TCC : efficace sur l’anxiété et la rumination, réduit l’impact émotionnel du SPM.
- Suppléments nutritionnels : calcium, magnésium, vitamines B6, D, et oméga-3 (effets anti-inflammatoires).
Vers une meilleure reconnaissance du SPM
Le SPM n’est ni un caprice, ni un simple inconfort passager. C’est un trouble neuro-hormonal complexe, avec des implications physiopathologiques profondes. Mieux le comprendre et le prendre au sérieux, c’est protéger la santé physique et mentale des femmes à court, moyen et long terme.
Mots clés : Syndrome ; prémenstruel ; santé ; cardiovasculaire ; femmes ;