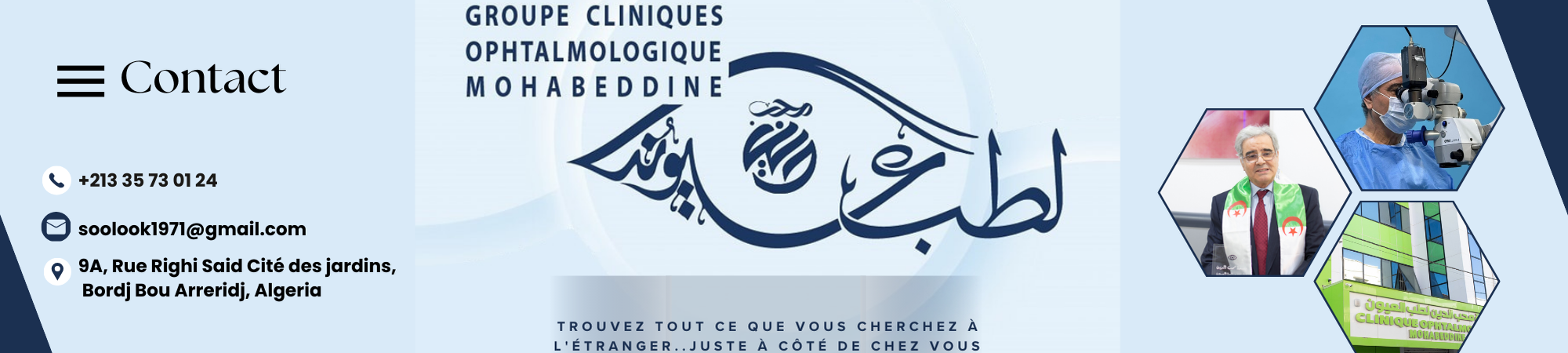Le bâillement est un réflexe universel. Il survient dès la vie fœtale et accompagne chacun de nous jusqu’à la fin de notre existence. En moyenne, un être humain bâille environ 250 000 fois au cours de sa vie. Si ce geste est souvent associé à l’ennui ou à la fatigue, il peut aussi être le signal d’un dysfonctionnement plus sérieux de l’organisme. Les spécialistes du sommeil alertent sur les conséquences médicales d’un bâillement trop fréquent.
Le bâillement : un réflexe sous contrôle neurologique
Le bâillement est un acte réflexe contrôlé par le cerveau, notamment par l’hypothalamus. Il se traduit par une ouverture large de la bouche, une inspiration profonde, suivie d’une courte expiration. Ce phénomène permet une meilleure oxygénation du cerveau, une régulation de la température cérébrale, et parfois même une réponse à un besoin d’éveil ou de stimulation.
Mais lorsque ce comportement devient excessif, il peut signaler un trouble neurologique ou une somnolence chronique. Et c’est précisément ce que souligne un récent rapport de l’American Academy of Sleep Medicine (AASM), l’institution de référence aux États-Unis en matière de troubles du sommeil.
Somnolence excessive : un danger silencieux
Pour les experts, des bâillements fréquents sont un signe de somnolence diurne excessive, un trouble sous-estimé mais aux effets potentiellement graves. La somnolence est une pathologie en soi. Elle compromet la vigilance, la concentration, et augmente les risques d’accidents domestiques, professionnels et routiers.
La somnolence chronique peut également entraîner un dérèglement de nombreuses fonctions vitales. Le manque de sommeil profond perturbe l’équilibre hormonal, affaiblit le système immunitaire, et contribue à l’installation de maladies chroniques.
Un sommeil insuffisant, des conséquences multiples
Un repos nocturne de moins de 7 à 8 heures par nuit — la durée recommandée pour les adultes — peut accentuer les risques de :
- Diabète de type 2, par résistance à l’insuline ;
- Hypertension artérielle et maladies cardiaques (infarctus, troubles du rythme) ;
- Accidents vasculaires cérébraux (AVC) ;
- Dépression et troubles de l’humeur ;
- Altérations cognitives, pertes de mémoire, troubles de l’attention ;
- Affaiblissement rénal et inflammation chronique.
Des pathologies neurologiques à ne pas exclure
Un bâillement répété n’est pas uniquement lié à la fatigue. Il peut aussi indiquer la présence de troubles neurologiques. Certains chercheurs évoquent des liens avec :
- L’hypertension intracrânienne ;
- Les migraines sévères ;
- La sclérose en plaques ;
- Une tumeur cérébrale ou une compression du tronc cérébral ;
- Une intoxication au monoxyde de carbone — un gaz inodore mais mortel à forte concentration.
Chez certains patients, le bâillement survient même en dehors de toute sensation de fatigue, comme un signal du système nerveux central confronté à une forme d’irritation ou de stress.
Une absence de bâillement aussi inquiétante
À l’inverse, chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, de sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou d’autres troubles neurodégénératifs, le bâillement peut disparaître. Cela s’explique par une altération des circuits neurologiques responsables de ce réflexe. Ce silence corporel est souvent un indice de plus d’un système nerveux endommagé.
Quand faut-il consulter ?
Un bâillement occasionnel est normal. En revanche, si les bâillements deviennent nombreux et incontrôlables — notamment en journée —, ou s’ils s’accompagnent de fatigue persistante, de maux de tête, de vertiges ou d’un état confusionnel, il est essentiel de consulter un médecin.
Un bilan du sommeil, un polysomnographe (examen de nuit), ou une imagerie cérébrale (IRM, scanner) peuvent aider à identifier l’origine du trouble.
Mots clés : sommeil ; bâillement ; santé ; IRM ; maladie ; cérébrale ; trouble ; cerveau ;